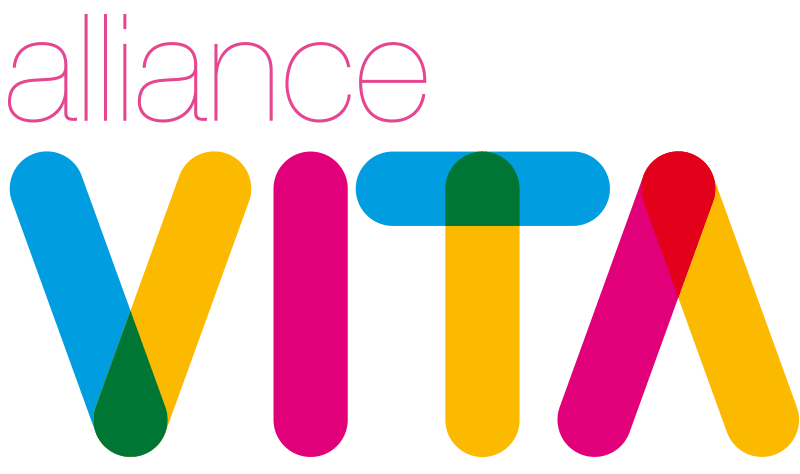IVG dans la constitution : la proposition de loi rejetée au Sénat
Mercredi 19 octobre 2022, les Sénateurs ont rejeté, par 172 voix contre 139, la proposition de loi de la sénatrice écologiste Mélanie Vogel qui entendait inscrire dans la constitution un « droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception ».
Comme cinq autres propositions de lois déposées dans les deux assemblées, cette proposition de loi avait été présentée en réaction à la décision Dobbs vs Jackson de la Cour suprême des Etats-Unis, le 24 juin 2022, qui annulait l’arrêt Roe vs Wade de 1973, supprimant ainsi la reconnaissance d’un « droit à l’avortement » au niveau fédéral.
Le débat
Signée par des membres de différents groupes au Sénat, la proposition de loi entendait renforcer la protection du « droit à l’avortement » en l’intégrant dans la Constitution française, afin de rendre plus difficile une éventuelle remise en question à l’avenir. La proposition de loi a reçu le soutien d’Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux.
Lors du débat, Agnès Canayer, sénatrice Les Républicains (LR) de Seine Maritime et rapporteur de la commission des lois, a pointé l’inutilité et l’inefficacité de cette proposition de loi. Selon elle, « l’inscription de l’IVG dénaturerait l’esprit de la Constitution et ouvrirait la boîte de Pandore. » Il s’agit de ne pas faire de la Constitution un « catalogue de droits », au risque de porter atteinte au « rôle protecteur de la norme suprême ». La sénatrice a rappelé que la Constitution ne pouvait être modifiée que pour certaines raisons bien identifiées. Or, l’inscription du droit à l’IVG ne pourrait être justifiée, selon elle, par aucune de ces raisons. Une autre sénatrice LR, Muriel Jourda, a tenu à mettre en garde contre le risque de légiférer « en réaction » et en abordant la question « par la fenêtre étroite de l’émotion ».
La différence de situation entre la France et les Etats-Unis a également été rappelée lors des débats, dans la mesure où la France n’est pas un Etat fédéral. La décision de la Cour suprême américaine répondait à la question de savoir si la législation sur l’avortement devait relever de l’Etat fédéral ou des Etats fédérés, et a jugé qu’il appartenait désormais aux Etats fédérés de légiférer sur l’avortement.
D’autres propositions à l’Assemblée nationale
A la date où cette proposition de loi est examinée au Sénat, l’examen de deux autres textes visant à constitutionnaliser l’IVG est déjà prévu à l’Assemblée nationale. Le 24 novembre, les députés examineront la proposition de loi de La France Insoumise (LFI) dans le cadre de la niche parlementaire de ce groupe. Quelques jours plus tard, c’est la proposition de loi de la députée Aurore Bergé (Renaissance), soutenue par le parti présidentiel, qui sera examinée dans la semaine du 28 novembre, et qui devrait être examinée en commission des lois dès le 9 novembre.
Pas moins de 6 propositions de lois ont été déposées pour constitutionnaliser l’IVG. Pourtant, à ce jour, il n’existe pas de consensus sur l’endroit où il faudrait ajouter cette disposition dans la constitution (ajout d’un article 66-2 ou inscription dans l’article 1er ou 34), ni sur sa rédaction, ce qui montre bien les difficultés que pose cette constitutionnalisation.
Lors de son intervention, Eric Dupont-Moretti a d’ores et déjà annoncé que le Gouvernement soutiendrait chacune des initiatives parlementaires pour constitutionnaliser le droit à l’IVG.
Pourtant, plusieurs juristes spécialistes du droit constitutionnel ont exprimé leurs réserves sur cette constitutionnalisation. Ainsi, dans un entretien au journal La Croix, le professeur Bertrand Mathieu a indiqué dès le mois de juin que l’avortement n’est pas un droit fondamental, et que la reconnaissance d’un véritable « droit à l’avortement » aboutirait à reconnaître à la femme « un droit absolu sur la vie du fœtus » alors que jusqu’à présent celui-ci a toujours bénéficié d’une protection constitutionnelle, menaçant ainsi « l’équilibre » établi par la loi dépénalisant l’IVG de 1975. Dans un entretien au Figaro publié le 18 octobre, Jean-Eric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, s’interroge : « Les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle veulent-ils une IVG complètement libre jusqu’au neuvième mois? On espère que non, même si leur texte y conduit tout droit. ».
Ce débat intervient au moment où les derniers chiffres de l’IVG publiés par la DREES en septembre indiquent que non seulement le nombre d’IVG en France est stable d’une année sur l’autre, « autour de 225 000 par an », mais aussi que « le taux global de recours à l’IVG tend à augmenter » et atteint 15,5 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2021.
L’IVG, un droit ?
Pour Alliance VITA, se concentrer sur le « droit » à l’avortement, c’est occulter les vrais enjeux de l’IVG aujourd’hui. Pour Caroline Roux, directrice générale adjointe, « à force de considérer l’avortement uniquement comme un droit, on cache les pressions – voire les violences psychiques – qui y conduisent dans nombre de cas » (Tribune La Croix, 28 juin 2022). Des raisons économiques peuvent également jouer un rôle, puisqu’un rapport de la DREES de 2020 révélait que les femmes aux revenus les plus faibles avortent plus souvent. Finalement, l’IVG apparaît de plus en plus comme un marqueur d’inégalités sociales. On peut s’étonner que dans les débats au Sénat, pas un mot n’ait été prononcé sur la prévention et l’accompagnement des femmes en situation précaire.