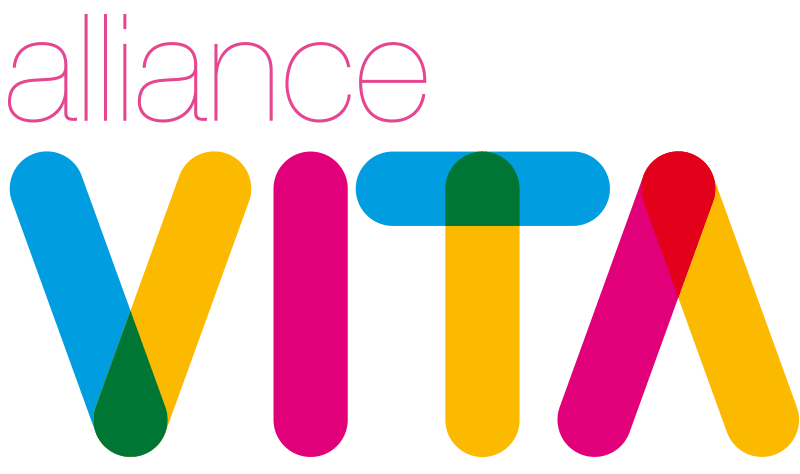Gamètes artificiels. Des souriceaux conçus uniquement par des cellules mâles.
Une étude publiée ce mercredi 15 mars 2023 dans la revue Nature fait état d’une nouvelle expérimentation menée par des scientifiques japonais, au sujet de ce qu’on appelle les « gamètes artificiels ». Ce sont des cellules reproductives (ovocyte, spermatozoïde) obtenus de manière artificielle, et non simplement prélevées ou recueillies.
Cette étude a été réalisée par l’équipe du biologiste du développement Katsuhiko Hayashi, de l’Université de Kyushu. Ses détails ont été présentés au “human gene-editing summit” (sommet sur l’édition du génome) au Crick Institute de Londres le 8 mars dernier.
L’un des moyens explorés pour obtenir des “gamètes artificiels” utilise la technique de reprogrammation cellulaire, dite IPS (cellules souches pluripotentes induites), découverte par un autre Japonais, le professeur Shinya Yamanaka, qui reçut pour cela le Prix Nobel de médecine en 2012.
Cette technique permet de redonner à une cellule dite adulte (comme une cellule de peau, par exemple) la possibilité de pluripotence d’une cellule-souche. La pluripotence est la capacité originelle pour une cellule de se différencier en tous les types cellulaires constituant un organisme adulte.
Dans l’étude mentionnée, ce sont des cellules de peau d’une souris mâles qui ont été reprogrammées. Comme chez l’humain, ces cellules animales sont toutes composées d’une paire de chromosomes sexuels, ici il s’agissait de males, donc une paire XY. Ces cellules de peau ont été artificiellement modifiées pour « perdre » leur chromosome Y et pour « accueillir » un deuxième chromosome X, dupliqué du premier. Les cellules devenues ainsi porteuses de la paire de chromosomes sexuels féminins XX ont pu alors être reprogrammées pour devenir pluripotentes. Elles ont ensuite été artificiellement contraintes de se différentier en cellules reproductrices, donc en ovocytes.
L’un des caractères inédits de cette expérimentation vient du fait que les cellules ainsi artificiellement obtenues ont acquis une capacité de fécondabilité. Ces ovocytes artificiels ont en effet été fécondés par du sperme de souris mâle, puis implantés dans un utérus de femelle souris.
Sur un total de 630 essais, 7 souriceaux, d’apparence normale, sont nés. En termes de chiffre, de l’aveu même de Hayashi, ce n’est pas encore une méthode très efficace.
Bien qu’évoquées et envisagées depuis longtemps, les applications humaines ne sont pas imminentes. Elles soulèvent indiscutablement de vertigineux enjeux éthiques, anthropologiques, philosophiques et sanitaires. Pour Robin Lovell-Badge, biologiste et généticien au Crick Institute de Londres : « on ne maîtrise pas encore pour l’homme la technologie qui a ici été utilisée pour transformer une cellule souche d’une souris mâle en ovocyte. Le processus prendrait aussi beaucoup plus longtemps. Ce serait un défi technique d’une tout autre ampleur, car il faudrait maintenir l’intégrité des échantillons en laboratoire sur une période beaucoup plus longue, ce qui multiplie les risques d’accidents ». Même constat pour le professeur George Daley de la Harvard Medical School pour le média britannique : « Faire cela sur des humains est plus difficile que la souris. Nous ne comprenons toujours pas assez la biologie unique de la gamétogenèse humaine (la formation de cellules reproductrices) pour reproduire le travail de Hayashi».
Au-delà des questions techniques se posent des interrogations éthiques. «Le fait de pouvoir faire quelque chose ne veut pas nécessairement dire qu’on doive le faire (…) particulièrement quand on parle d’une espèce d’être humain», a aussi commenté Nitzan Gonen, directeur du laboratoire sur la détermination des sexes à l’Université israélienne Bar-Ilan University.
Pour Alliance VITA, il est compréhensible que ces recherches soient fascinantes pour ceux qui les mènent. Elles peuvent permettre de mieux comprendre les procédés de gamétogenèse et leurs dysfonctionnements. Mais les applications humaines tapies derrière sont très inquiétantes. Notre époque a déjà vu naitre des bébés génétiquement modifiés, même plus des essais sur l’homme, mais des essais d’homme. Ces expérimentations animales impliquent de renforcer à l’international les garde-fous pour nous prémunir de telles expérimentations sur l’être humain.
Pour aller plus loin :
Gamètes artificiels, toujours plus loin ? 2021
Bébés sur mesure – le monde des meilleurs. Blanche STREB (Artège, 2018)
La fabrication artificielle de spermatozoïdes – 2016